 |
~ La mémoire humaine ~ La mémoire humaine a-t-elle une limite ? ---------------- Bienvenue sur le site de notre TPE, réalisé par Emma B., Honorine D. et Léonie D., élèves de 1ère S au lycée Blaise Pascal de Longuenesse en 2015/2016. Bonne visite ! |
 |
~ La mémoire humaine ~ La mémoire humaine a-t-elle une limite ? ---------------- Bienvenue sur le site de notre TPE, réalisé par Emma B., Honorine D. et Léonie D., élèves de 1ère S au lycée Blaise Pascal de Longuenesse en 2015/2016. Bonne visite ! |

 Quel est votre plus ancien souvenir ? La bouée à tête de canard de vos premières vacances à la mer ? La glace de papa fondu sur le bout de votre petit nez ? Une rencontre magique avec le père Noël dans un grand magasin ? La naissance de votre petit frère ? Quelle que soit sa nature, il y a peu de chance que votre tout premier souvenir soit antérieur à votre deuxième, voire même troisième anniversaire : nous oublions tous les premières années de notre vie. Baptisé « amnésie infantile », ce phénomène universel intrigue psychanalystes et psychologues depuis plus d’un siècle.
Quel est votre plus ancien souvenir ? La bouée à tête de canard de vos premières vacances à la mer ? La glace de papa fondu sur le bout de votre petit nez ? Une rencontre magique avec le père Noël dans un grand magasin ? La naissance de votre petit frère ? Quelle que soit sa nature, il y a peu de chance que votre tout premier souvenir soit antérieur à votre deuxième, voire même troisième anniversaire : nous oublions tous les premières années de notre vie. Baptisé « amnésie infantile », ce phénomène universel intrigue psychanalystes et psychologues depuis plus d’un siècle.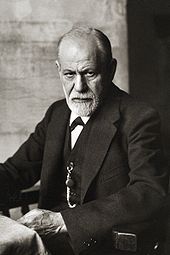
 Même s'il est impossible de réaliser ces expériences chez l'Homme, il est raisonnable de penser que l'amnésie infantile est due, au moins en partie, à un niveau plus élevé de neurogenèse durant l'enfance.
Même s'il est impossible de réaliser ces expériences chez l'Homme, il est raisonnable de penser que l'amnésie infantile est due, au moins en partie, à un niveau plus élevé de neurogenèse durant l'enfance. Malgré ce que nous pouvons penser, l’oubli ne serait pas le seul responsable de l’amnésie infantile. Il ne constitue qu’une des composantes de ce trouble énigmatique. Si nous avons oublié nos premiers mois ou années de vie, c’est aussi parce que les souvenirs qui leurs correspondent n’ont tout simplement pas été enregistrés ! Ou qu’ils ont été enregistrés de façon partielle. Des travaux réalisés en 2012 par l'équipe d’une professeure en psychologie à l’université d’Otago en Nouvelle-Zélande pourront nous éclairer sur cette hypothèse. Après avoir interrogé 47 enfants âgés de 2 à 5 ans dans les semaines qui suivaient la naissance de leur petit frère/sœur, la chercheuse a constaté un fait étonnant. En effet, les enfants les plus jeunes au moment de la naissance de leur frère/sœur se souvenaient de moins de détails de l’événement que ceux qui étaient plus âgés. L’intervalle de temps qui s’est écoulé entre la naissance et l’interrogation est trop court pour qu’ils aient oubliés des détails. C’est donc au moment de l’événement que les enfants les plus jeunes ont enregistré moins d’informations que les enfants plus âgés.
Malgré ce que nous pouvons penser, l’oubli ne serait pas le seul responsable de l’amnésie infantile. Il ne constitue qu’une des composantes de ce trouble énigmatique. Si nous avons oublié nos premiers mois ou années de vie, c’est aussi parce que les souvenirs qui leurs correspondent n’ont tout simplement pas été enregistrés ! Ou qu’ils ont été enregistrés de façon partielle. Des travaux réalisés en 2012 par l'équipe d’une professeure en psychologie à l’université d’Otago en Nouvelle-Zélande pourront nous éclairer sur cette hypothèse. Après avoir interrogé 47 enfants âgés de 2 à 5 ans dans les semaines qui suivaient la naissance de leur petit frère/sœur, la chercheuse a constaté un fait étonnant. En effet, les enfants les plus jeunes au moment de la naissance de leur frère/sœur se souvenaient de moins de détails de l’événement que ceux qui étaient plus âgés. L’intervalle de temps qui s’est écoulé entre la naissance et l’interrogation est trop court pour qu’ils aient oubliés des détails. C’est donc au moment de l’événement que les enfants les plus jeunes ont enregistré moins d’informations que les enfants plus âgés. nourrissons ont aussi une très grande capacité à reconnaître des visages (outre ceux de leurs parents). Des études en février 2014 par l’université d’Aarrhus au Danemark ont été réalisées. Des enfants de 3 ans ont été capables de se souvenir d’un visage qu’ils n’avaient vu qu’une seule fois à l’âge d’un an.
nourrissons ont aussi une très grande capacité à reconnaître des visages (outre ceux de leurs parents). Des études en février 2014 par l’université d’Aarrhus au Danemark ont été réalisées. Des enfants de 3 ans ont été capables de se souvenir d’un visage qu’ils n’avaient vu qu’une seule fois à l’âge d’un an. Pour les neurobiologistes, l’âge de deux ans est un âge charnière pour une autre raison. L’hippocampe est un système cérébral complexe constitué de différentes sous-structures dont le rythme de maturation diffère de l’une à l’autre. Or, l’une des aires les plus précoces de l’hippocampe n’est mature que vers l’âge de deux ans. Ceci expliquerait l’absence totale de souvenirs autobiographiques avant cet âge. De plus, les autres structures de l’hippocampe arrivent à maturation progressivement. Cela justifierait les améliorations de la mémoire entre 2 et 7 ans.
Pour les neurobiologistes, l’âge de deux ans est un âge charnière pour une autre raison. L’hippocampe est un système cérébral complexe constitué de différentes sous-structures dont le rythme de maturation diffère de l’une à l’autre. Or, l’une des aires les plus précoces de l’hippocampe n’est mature que vers l’âge de deux ans. Ceci expliquerait l’absence totale de souvenirs autobiographiques avant cet âge. De plus, les autres structures de l’hippocampe arrivent à maturation progressivement. Cela justifierait les améliorations de la mémoire entre 2 et 7 ans.
 Mais même s'ils ont les capacités linguistiques, les jeunes enfants ne racontent pas spontanément les événements qui leurs sont arrivés. Or c'est en racontant que l'on structure sa mémoire autobiographique. Il s'agit d'une pratique culturelle où les parents jouent un rôle important. Ils doivent inciter le récit en posant des questions complémentaires sur les protagonistes, le contexte, les états émotionnels (discours élaboratif), afin que leurs enfants enrichissent la représentation qu'ils se construisent de l'événement. Plus riche, le souvenir devient plus stable. C’est la qualité du dialogue entre les enfants et leurs parents qui expliqueraient la qualité et la précocité de nos plus anciens souvenirs.
Mais même s'ils ont les capacités linguistiques, les jeunes enfants ne racontent pas spontanément les événements qui leurs sont arrivés. Or c'est en racontant que l'on structure sa mémoire autobiographique. Il s'agit d'une pratique culturelle où les parents jouent un rôle important. Ils doivent inciter le récit en posant des questions complémentaires sur les protagonistes, le contexte, les états émotionnels (discours élaboratif), afin que leurs enfants enrichissent la représentation qu'ils se construisent de l'événement. Plus riche, le souvenir devient plus stable. C’est la qualité du dialogue entre les enfants et leurs parents qui expliqueraient la qualité et la précocité de nos plus anciens souvenirs. Reste que ni les neurobiologistes ni les psychologues ne parviennent pour l'heure à expliquer comment notre cerveau « choisit » les souvenirs à conserver. Qu'est-ce qui explique que parmi tous les souvenirs autobiographiques constitués entre 3 et 7 ans, seule une partie d'entre eux sera stabilisée dans la mémoire autobiographique à long terme ? La question reste ouverte.
Reste que ni les neurobiologistes ni les psychologues ne parviennent pour l'heure à expliquer comment notre cerveau « choisit » les souvenirs à conserver. Qu'est-ce qui explique que parmi tous les souvenirs autobiographiques constitués entre 3 et 7 ans, seule une partie d'entre eux sera stabilisée dans la mémoire autobiographique à long terme ? La question reste ouverte.